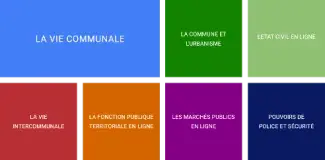La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 vise à faciliter la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette (ZAN) fixés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (dite « Climat et résilience »).
1. Constat et définitions
Chaque année, la France perd 20 000 à 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers sous la pression des activités humaines.
L’artificialisation des sols consiste à transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions urbaines ou de transport.
Afin de préciser cette notion d’artificialisation des sols, la loi « Climat et résilience » a donné les définitions suivantes (art. L 101-2-1 du code de l’urbanisme) :
- l’artificialisation est définie comme étant l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ;
- la renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ;
- l’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés ;
- la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné (art. 194 de la loi Climat et résilience).
Ces définitions sont complétées par le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 qui précise les surfaces considérées comme artificialisées et celles considérées comme non artificialisées.
2. Objectifs
L’article 191 de la loi « Climat et résilience » a fixé un double objectif :
- diviser par deux, au niveau national, le rythme d’artificialisation entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente (et de le faire passer ainsi de 250 000 - rythme de 2011 à 2021 - à 125 000 hectares) ;
- atteindre d’ici à 2050 zéro artificialisation nette, c’est-à-dire au moins autant de surfaces renaturées que de surfaces artificialisées.
3. Apports de la loi du 20 juillet 2023
La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 prévoit notamment :
- des délais supplémentaires pour intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents d’urbanisme locaux : soit jusqu’au 22 novembre 2024 pour les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), jusqu’au 22 février 2027 pour les SCOT et jusqu’au 22 février 2028 pour les plans locaux d’urbanisme (PLU) ;
- de nouveaux outils à disposition des maires pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation : comptabilisation en net de l’artificialisation dès la première période décennale 2021-2031, droit de préemption urbain élargi afin que celui-ci soit permis en cas de renaturation, sursis à statuer lorsqu’un projet pourrait mettre en péril l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation à l’horizon 2031 ;
- la création d’une « garantie rurale » d’un hectare au profit de toutes les communes, à condition d’être couvertes par un PLU, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026. Ce droit à construire pourra être mutualisé à l’échelle intercommunale. Une majoration est proposée, à hauteur de 0,5 hectare par commune déléguée au sein d’une commune nouvelle tout en plafonnant cette majoration à 2 hectares ;
- dans l’enveloppe de 125 000 hectares d’ici 2031, un forfait national de 12 500 hectares pour les projets d’envergure nationale ou européenne (projets industriels d’intérêt majeur, construction de lignes à grande vitesse, prisons, futurs réacteurs nucléaires...) pour l’ensemble du pays, dont « 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un SRADDET au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031 ». Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme viendra préciser cette répartition ;
- l’institution d’une « commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols », qui pourra être saisie à la demande de la région en cas de désaccord sur la liste des grands projets ;
- une nouvelle instance régionale de gouvernance, la conférence ZAN, qui doit rassembler des élus locaux compétents en matière d’urbanisme et de planification et des représentants de l’État. Cette conférence ZAN se réunira sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et devra être consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure nationale ou européenne.